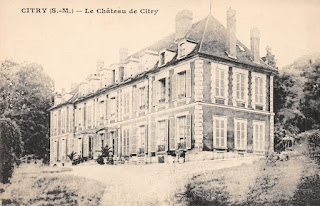Lors de notre passage à Meung-sur-Loire en août 2016,
nous avons visité le château et nous y avons rencontré les propriétaires actuels, Madame et Monsieur Lelevé. À cette occasion, ils nous ont appris que le château avait eu une châtelaine originaire du Québec au XIXe siècle. Ce fait nous ayant intrigués, nous avons effectué quelques recherches que nous vous partageons avec plaisir.
La présence de Québécois au château de Meung-sur-Loire origine d’une nébuleuse composée de personnages provenant du milieu du livre, de l’imprimerie, de l’édition, du commerce entre l’Europe et l’Amérique principalement le Bas-Canada (maintenant le Québec) et la politique canadienne au XIXe siècle.
 |
| Château de Meung-sur-Loire |
Depuis 1760 au moment où le gouverneur Vaudreuil cédait le Canada et toutes ses dépendances à la force d'invasion britannique à Montréal et la signature du traité de Paris en 1763 qui mit un terme à la guerre de Sept Ans, le Canada est devenu une colonie sous domination anglaise. La langue, la religion et le droit civil en usage à l’époque de la Nouvelle-France sont pour l’essentiel demeurés les mêmes. Cependant, les domaines judiciaire, économique et politique passent sous ressort britannique. Par la suite, certaines réformes politiques sont apportées sans grands effets sur les conditions économiques des francophones. Plusieurs mouvements de revendication émergent au début du XIXe et mèneront aux troubles sanglants de 1837-38 où plusieurs insurgés seront pendus ou déportés. Un des principaux leaders politiques à cette époque était Louis-Joseph Papineau, seigneur de la Petite Nation.
 |
Jean-Hector Bossange
(1795-1884) |
L’histoire débute par l’arrivée de Jean-Hector Bossange à Montréal en 1815 pour y fonder, en association avec Denis-Benjamin Papineau, une nouvelle librairie sous la raison sociale de «Maison Bossange et Papineau». Cette société qualifiée de librairie est aussi une maison de commerce qui importe et revend divers articles de consommation. Il l’exploitera de septembre 1815 à février 1819 puis retournera à Paris pour y lancer une nouvelle librairie avec son frère Adolphe. Né le 28 avril 1795 à Paris, Jean-Hector Bossange était le fils de Martin Bossange, libraire, éditeur et exportateur de livres. Il immigra aux États-Unis en 1812 pour terminer ses études chez Henry Chériot, un correspondant de son père, où il apprend l’anglais et la tenue de livres. On ne sait pas vraiment qui du père ou du fils est propriétaire de la librairie Bossange de Montréal. Toutefois en 1815, Hector n’a que 20 ans et la maison Bossange de Paris paraît sa principale source d’approvisionnement. Les marchandises transitent le plus souvent par l’Angleterre comme il était d’usage à cette époque, mais parfois aussi par New York où Martin Bossange entretient des relations suivies avec certains libraires.
 |
Martin Bossange
(1766-1865) |
En France, la famille Bossange se fie connaître principalement en raison des succès de Martin-Adolphe Bossange. Il monta à Paris vers 1785 pour travailler dans la libraire de Edme-Jean Lejay. Devenu libraire et commissionnaire en librairie en 1787, il s'associa l'année suivante avec le libraire lyonnais Jean-Marie Besson, sous la raison sociale « Bossange et Cie ». En 1792, il forme une association de libraires avec deux Lyonnais, Besson et Joseph-René Masson (aucun lien avec les Masson de Terrebonne) qui deviendra en 1798 la société «Bossange, Masson et Besson». Cette maison se tournera rapidement vers le commerce international de livres. Il ouvre ainsi une librairie en Haïti dès 1801, puis, en dépit du blocus continental décrété par Napoléon, un comptoir en Angleterre. Après la fin de l'Empire, il crée des filiales à Madrid, Naples, Leipzig, Mexico et Rio de Janeiro. La tête de pont de ces échanges internationaux est Londres où Bossange et ses associés s'unissent à Barthès et Lowell pour y fonder une librairie importante. En 1818, Bossange se sépare de Masson et revend l'imprimerie qui fabriquait le Journal de la librairie. Son activité se concentre sur l'édition de nouveautés, le négoce d'éditions plus anciennes et la librairie de commission avec l'étranger. En 1825, son siège se situe au 60 rue de Richelieu, galerie de Bossange père, un lieu distinct de la maison «Bossange et frères» située au 12 rue de Seine fondée quelques années auparavant par ses fils, Jean-Hector (1795-1884) de retour du Canada et Adolphe (1797-1862).
À l’automne 1830, Martin Bossange dépose le bilan à la suite de nombreuses difficultés financières, mais il réussit à reprendre ses activités en Allemagne, à Leipzig, où il s'associe à Johann Jakob Weber avec lequel il édite l'un des tout premiers magazines destinés aux familles. Martin prend sa retraite en 1837 après avoir revendu ses parts allemandes à Brockhaus. Ses fils, Hector et Adolphe, développent une activité indépendante de librairie internationale, activité que poursuivront Gustave et Edmond, les deux enfants d'Hector, jusque vers la fin du XIXe siècle. La famille Bossange restera, avec Louis Hachette, l'une des premières maisons d’édition française à avoir développé le commerce du livre à l'échelle mondiale.
Lorsque Jean-Hector Bossange décide de retourner en France en 1819, cette première librairie francophone à Montréal semble encore assez modeste. Il cède ses parts à son associé Denis-Benjamin Papineau qui s’empresse de revendre à Théophile Dufort. En 1823, c’est Édouard-Raymond Fabre qui rachète la librairie tout en maintenant ses liens avec les Parisiens jusqu’en 1828. Véritable succès, la librairie Fabre deviendra la plus importante librairie francophone à Montréal jusqu’au milieu du XIXe siècle. Les familles Fabre et Bossange ont plus que des liens commerciaux. Jean-Hector Bossange épousa Julie Fabre, la soeur d’Édouard-Raymond Fabre en 1816. Celui-ci apprendra d’ailleurs le métier de libraire à Paris chez Martin Bossange.
 |
Édouard Raymond Fabre
(1799-1854) |
La librairie d’Édouard Raymond Fabre deviendra rapidement un lieu de rendez-vous des élites politiques et culturelles. C’est pourquoi le nom d’Édouard Raymond Fabre sera associé à la mouvance sociale et politique canadienne-française de l’époque. C’est ainsi qu’il sera amené à côtoyer Louis-Joseph Papineau pendant la période trouble de 1837-38 et à lui conseiller de s’exiler à Paris. D’ailleurs, il demeurera toute sa vie un inconditionnel de Louis-Joseph Papineau. Fabre le visitera régulièrement en 1843 chez Hector Bossange qui l’a accueilli à Paris après son exil aux États-Unis. C’est également lui qui s’entremettra pour unir en 1845 son neveu Édouard Bossange, fils d’Hector Bossange, son beau-frère, à Marie Masson, fille de Joseph Masson, seigneur de Terrebonne au Québec.
Les affaires de Jean-Hector Bossange tendent à décliner à la fin des années 1820. Victime de la crise de la librairie qui secoue la France à cette époque, il déclare faillite en 1830. Il retourne peu à peu à ses activités commerciales et, signe de la bonne reprise de ses affaires, en 1845, année du mariage de son fils Édouard avec Marie Masson de Terrebonne, il publie un imposant catalogue qui propose plus de 30 000 ouvrages : « catalogue général de Hector Bossange » d’un millier de pages. À l’automne 1841 et durant l’année 1842, il effectue un long voyage au Canada et aux États-Unis. En partenariat avec Alfred Morel, ils ouvrent une nouvelle librairie à Québec sous le nom de «Nouvelle Maison française» en 1851. Afin de mieux comprendre l’influence qu’aura eue la famille Bossange au cours du XIXe siècle, je vous invite à lire l’article rédigé par Anthony Groleau-Fricard de l’Université Paris I et publié à l’intérieur du livre intitulé «La Capricieuse (1855): poupe et proue : les relations France-Québec (1760-1914)» dont vous trouverez la référence ci-dessous.
Denis-Benjamin et Louis-Joseph Papineau
 |
Denis-Benjamin Papineau
(1789-1854) |
L’associé de Jean-Hector Bossange à Montréal en 1815, Denis-Benjamin Papineau (1789-1854), fut tour à tour agent seigneurial, libraire, seigneur, marchand, fonctionnaire, juge de paix et homme politique. Il était également le frère de Louis-Joseph Papineau, avocat et homme politique.
 |
Loui-Joseph Papineau
(1786-1871) |
Louis-Joseph Papineau, élu orateur de la Chambre d’assemblée du Bas-Canada à 29 ans, rejoindra les rangs du Parti canadien, rebaptisé en 1826 Parti patriote et sera un chef de file du mouvement de rébellion des patriotes de 1837. Bien qu’il prôna la modération, le gouverneur Gosford lança un mandat d’amener contre lui. Papineau dut prendre le chemin de l’exil. Il se réfugia successivement au Vermont, à New York, puis à Paris avec sa femme et trois de ses enfants. Il ne reviendra au pays qu’en septembre 1845 après l’obtention de son pardon.
Octave Crémazie
 |
Octave Crémazie
(1827-1879) |
Un autre événement mal connu des Québécois relie la famille Bossange à l’histoire du Québec. Le 11 novembre 1862, Octave Crémazie, l'un des plus populaires poètes canadiens-français en raison de ses chants patriotiques, disparaît. Seuls ses proches savent que, sur les conseils de son frère Jacques, le juriste, il s’est enfui à Paris afin d’éviter la prison. Sept jours plus tard, la librairie «J. & O. Crémazie » spécialisée dans le commerce de la papeterie, des articles de bureau et divers produits déclare faillite. Octave, le public l’apprendra seulement en 1864, a émis depuis plusieurs années de faux billets à ordre afin de recueillir des fonds permettant de garder à flot les liquidités de la boutique. En exil définitif sous le nom de Jules Fontaine, il est accueilli par les Bossange qui lui procurent de modestes emplois, mais ce sont ses frères qui le feront vivre. Afin d'illustrer la proximité de la famille Bossange avec le Québec voici la description d'un événement survenu le 14 octobre 1876. Hector Bossange et sa femme, Julie Fabre, célébrèrent le soixantième anniversaire de leur mariage au château de Citry. Le chantre de cette fête est Octave Crémazie, l'ancien libraire et poète de Québec qui avait été accueilli au château, ayant fui le Canada pour échapper à ses créanciers. Il mourra en exil au Havre en 1879.
Joseph Masson
 |
Joseph Masson
(1791-1847) |
Joseph Masson a occupé une place de premier plan dans la société de son époque. Né à Saint-Eustache au Québec en 1791, fils de menuisier, il est « placé » très jeune comme commis au magasin général de son village. En 1812, il passe au service de Hugh Robertson & Co, un grossiste de Montréal, dont il devient bientôt l’associé. Ils demeureront associés en affaire toute leur vie. Hugh Robertson vivait à Glasgow en Écosse et Joseph Masson à Montréal et à Québec. En 1818, il épouse Marie-Geneviève-Sophie Raymond. Ils ont plusieurs enfants, dont sa fille aînée Marie qui n’acquit en 1824 et qui épousera Édouard Bossange en 1845. D’une foi chrétienne bien enracinée, c’est un travailleur acharné, honnête et estimé de tous. Tout en bâtissant sa fortune, il participe à tous les grands projets de son époque : construction de la basilique Notre-Dame, creusage du canal Lachine, construction du premier chemin de fer canadien entre le Richelieu et le Saint-Laurent. Vice-président de la ville de Montréal, il sera choisi comme Conseiller législatif du Bas-Canada en 1834.
 |
Louis-Hyppolite Lafontaine
(1807-1864) |
C’est ainsi qu’il sera appelé à côtoyer les principaux hommes politiques de son époque comme Louis-Hippolyte La Fontaine et Louis-Joseph Papineau qui à un moment ou à un autre ont tous été reçus chez les Bossange à Paris. Joseph Masson a sans doute été l’un des hommes d’affaires canadiens les plus importants du Bas-Canada au XIXe siècle. En 1832, Joseph Masson se porte acquéreur de la seigneurie de Terrebonne. Foudroyé par la maladie, il y mourut le 15 mai 1847, à l’âge de 56 ans. Il laissa à ses héritiers une fortune considérable et il est qualifié de « premier millionnaire canadien-français ».
Édouard Bossange
 |
Édouard Bossange
(1820-1900) |
Né le 22 août 1820 du mariage de Jean-Hector Bossange (1795-1884) avec Marie-Julie Fabre (1796-1833) , il partit jeune pour New York en 1840 ou 1841. Il ne se borna pas à son seul travail d’éditeur et de courtier en librairie, ayant pris la nationalité américaine pour ses affaires, il fit aux États-Unis une superbe fortune dans des spéculations immobilières.
Il rencontra sans doute sa future épouse, Marie Masson, lors d’une visite à Montréal en 1843 où il fut reçu par les Masson à la seigneurie de Terrebonne. L’année suivante, Joseph accompagné de sa fille Marie se rend à Glasgow chez Hugh Robertson, son associé, à Londres puis à Paris où ils sont reçus par la famille Bossange. C’est le père d’Édouard, Hectore Bossange qui se charge de faire la demande de la main de Marie auprès de Joseph Masson, comme c’était la coutume à l’époque. Celui-ci refuse prétextant que sa fille est beaucoup trop jeune et que son futur mari devra être bien établi avant de penser au mariage.
Malgré les refus répétés et après avoir attendu près de trois ans, Édouard Bossange et Marie Masson se marièrent le 25 septembre 1845 à Terrebonne sans l'autorisation ni la présence de Joseph et Sophie Masson, respectivement père et mère de la mariée. Ils auront un premier fils nommé Édouard, citoyen américain né à New York le 22 novembre 1846, qui se distinguera par ses actes de bravoure au château de Meung-sur-Loire lors de la guerre de 1871 contre la Prusse.
Ils rentrèrent en France en 1855, fortune faite, Édouard avait trente-cinq ans. Il acheta alors le château de Citry, située dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France, qu’il revendit en 1859 à son père (Hector), quand il devint propriétaire, le 24 novembre 1859, du château de Meung-sur-Loire, après avoir envisagé d’acquérir celui de La Ferté-Saint-Aubin dont ne voulut pas sa femme Marie en raison des douves pleines d’eau et des risques de noyade pour les enfants.
Hector Bossange et Julie Fabre se retirèrent au château de Citry où mourut Julie à 86 ans, le 2 août 1883. Hector s’installe alors chez son fils Édouard à Meung où il meurt à 88 ans, le 10 janvier 1884. Il fut inhumé au cimetière de Meung-sur-Loire. Après le décès de Marie Masson, à Meung-sur-Loire le 17 février 1891, sa fille Marie-Julie, née à Terrebonne le 30 juillet 1852, et Jean-Luizy-Robert Lesourd (1846-1909), qui s’étaient mariés le 27 août 1874, s’installèrent au château, dont ils héritèrent après la mort de Édouard Bossange, à Meung-sur-Loire, le 8 janvier 1900.
Comme nous pouvons le constater, l'union de ces deux familles Masson et Bossange n'est pas le fruit du hasard, mais s'inscrit parfaitement dans le cercle d'influence qu'ont construits et entretenus les patriarches Martin Bossange et son fils Jean-Hector et Joseph Masson. Des hommes partis de rien et qui ont édifié, chacun de son côté de l'Atlantique, et chacun à sa manière, un empire financier et familial qui se perpétua au-delà du XIXe siècle.
C’est ainsi qu’au cours des décades suivantes, les cousins et cousines français ont côtoyé les cousins et cousines québécois au château de Meung-sur-Loire.
Références
- Histoire de la librairie au Québec, Fernande Roy, Éditions Leméac, 2000
- Joseph Masson, Dernier seigneur de Terrebonne 1791-1847, par Henri Masson, à comte d’auteur, 1972
- La Capricieuse (1855) poupe et proue - relations France-Québec (1760-1914), sous la direction de Yvan Lamonde et Didier Poton, Les Presses de l’Université Laval, 2006
- Les Canadiens en France (1815-1855), Claude Galarneau, Les Cahiers des dix , n° 44, 1989, p. 135-181.
 |
| (cliquer sur l’image pour l’agrandir) |
EnregistrerEnregistrer